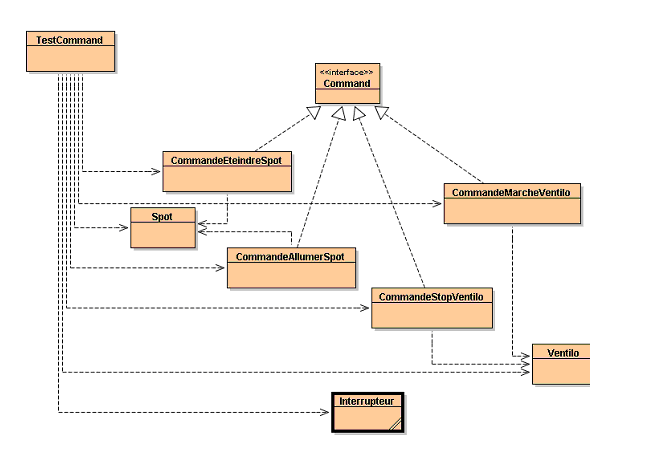
uv16472
Vérifier par les tableaux sémantiques ou le calcul des séquents que ~ 'E'(x , y)(cube(x) &cube(y) & aGauche(y , x)) est conséquence logique des prémisses suivantes :(i) 'A' (x , y)(aGauche(x , y) -> plusGrand(x , y))
(ii) 'A' (x)(cube(x) -> petit(x ))
(iii) 'A' (x)(tétraèdre(x) -> petit(x ))
(iv) 'A' (x , y)(( petit(x) & petit(y))-> ~plusGrand(x , y))
étudiant(<NOM> , <MATRICULE> , <LISTE de NOTES>).
Une note est un terme : dh(<NUMERO DH> , <NOTE>).
Exemple :
étudiant(et1 , i12345 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 0) ]).
étudiant(et5 , i12349 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 0) ]).
étudiant(et2 , i12346 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 0) ]).
étudiant(et3 , i12347 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 0) ]).
étudiant(et4 , i12348 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 0) ]).
étudiant(et6 , i12350 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 0) ]).
étudiant(et71 , i12351 , [dh(1 , 5) , dh(2 , 3) , dh(4 , 2) , dh(8 , 5) , dh(3 , 5) ]).
Remarque : ici, les DH sont tous notés sur 5.
On obtient la liste des étudiants (plus facile à manipuler) simplement par :
listeEtudiants(L) :- setof(étudiant(N , M , DH) , étudiant(N , M , DH) , L).
exemple en reprenant l'exemple ci dessus :
?- listeEtudiants(L) .
L = [étudiant(et1, i12345, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 0)]), étudiant(et5, i12349, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 0)]), étudiant(et2, i12346, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 0)]), étudiant(et3, i12347, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 0)]), étudiant(et4, i12348, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 0)]), étudiant(et6, i12350, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 0)]), étudiant(et71, i12351, [dh(1, 5), dh(2, 3), dh(4, 2), dh(8, 5), dh(3, 5)])]
Les règles de calcul du bonus sont :
1 point pour au moins 10 DH rendus avec une note > 0
2 points pour au moins 8 DH rendus avec une note > 2
3 points pour au moins 9 DH rendus avec une note > 2 dont 4 avec la note 5
0 point dans tous les autres cas.
Alors on ajoute 3 paramètres aux termes étudiant/3 , les 3 champs <Nb SUP0> , <Nb SUP2> , <Nb MAX> , soient le nombre de DH rendus avec une note >0 , le nombre de DH rendus avec une note >2 , le nombre de DH rendus avec la note 5
Donc on a maintenant
étudiant(<NOM>,<MAT>,<NOTES>,<Nb SUP0>,<Nb SUP2>,<Nb MAX>).
La nouvelle liste d'étudiants est obtenue par :
listeEtudiantsRendusSup2MAX([] , []).
listeEtudiantsRendusSup2MAX([étudiant(N , M , DH) | L] , [étudiant(N , M , DH , Rendus , SUP2 , MAX) | L1]) :-
sansZero(DH , DH1) , length(DH1 , Rendus),
sup2(DH1 , DH2) , length(DH2 , SUP2),
max(DH2 , DH3) , length(DH3 , MAX),
listeEtudiantsRendusSup2MAX(L ,L1).
sansZero([] , []) .
sansZero([dh(_ , Note) | L] , L1) :- compare(= , Note , 0) , sansZero(L , L1).
sansZero([dh(Nu , Note) | L] , [dh(Nu , Note) | L1]) :- compare(> , Note , 0) , sansZero(L , L1).
sup2([] , []) .
sup2([dh(_ , Note) | L] , L1) :- compare(< , Note , 3) , sup2(L , L1).
sup2([dh(Nu , Note) | L] , [dh(Nu , Note) | L1]) :- compare(> , Note , 2) , sup2(L , L1).
max([] , []) .
max([dh(_ , Note) | L] , L1) :- compare(< , Note , 5) , max(L , L1).
max([dh(Nu , Note) | L] , [dh(Nu , Note) | L1]) :- compare(= , Note , 5) , max(L , L1).
Rappel : compare(?Order, +Term1, +Term2) : Détermine ou teste l'Order entre 2 termes dans l'ordre standard
des termes. Order peut prendre les valeurs <, > ou =.
QUESTION : Ajouter au programme Prolog ci dessus la procédure Prolog qui retourne la liste des bonus selon les règles fixées.
listeBONUS(LISTEBONUS) :- /* à completer */
LISTEBONUS est donc une liste de termes de la forme : bonus(<NOM> , <MATRICULE> , <BONUS>).
le premier exemple donné dans ESC/JAVA est Bag.java. Complètement documenté en ESCJAVA on obtient :
| class Bag {
/*@ non_null */ int[] a; int n; //@ invariant 0 <= n && n <= a.length; //@ requires input != null && input.length>=1; //@ensures n==a.length; //@ensures (\forall int k; k>=0 && k<input.length ==> input[k]==a[k]); Bag(int[] input) { n = input.length; a = new int[n]; System.arraycopy(input, 0, a, 0, n); }
//@ requires n >= 1; //@ensures (\forall int k; k>=0 && k<n ==> \result<=a[k]); int extractMin() { int m = Integer.MAX_VALUE; //@assume (\forall int k; k>=0 && k<n ==> a[k]<m); int mindex = 0; /*@ loop_invariant (\forall int k; k>=0 && k<i ==> m<=a[k]) && 0 <= mindex && mindex <= i && i>=0 && i<=n;*/ //@decreases n-i; for (int i = 0; i < n; i++) { if (a[i] < m) {mindex = i; m = a[i]; } } /*@assert (\forall int k; k>=0 && k<n ==> m<=a[k]) && 0 <= mindex && mindex <= n;*/ n--; a[mindex] = a[n]; //@assert (\forall int k; k>=0 && k<n ==> m<=a[k]); return m; } } |
QUESTION1 : Reprendre le corps de la méthode extractMin() y compris les commentaires ESC/JAVA, pour le réécrire selon le formalisme de la logique de HOARE et en transformant la boucle "for" en une boucle "while".
Remarque : la formule ('A' k : k>=0 & k<i ==> m<=a[k]) est considérée comme vraie " par défaut " quand i=0 (puisqu'il n'existe pas de k donc de a[k]
QUESTION2 : Enoncer toutes les obligations de preuves pour prouver la boucle " while " obtenue. (ATTENTION : les démonstrations ne sont pas demandées ici…)
QUESTION3 : établir la preuve de la terminaison de la boucle (le point 5 du canevas)
4-Java (5 points) : Pattern Commande
Le langage java ne permet pas de passer une procédure en paramètre ou de l'affecter à une variable pour réaliser l'équivalent d'un 'callback'. Pour affecter à différentes structures de commande des fonctions différentes on peut utiliser le pattern dit 'pattern Command'. L'interface ci-dessous
public interface Command {
public abstract void execute ( );
}
peut donc être implémenté par des classes concrètes, la méthode execute étant spécialisée en conséquence. Différents objets de CommandeConcrète peuvent alors être affectés à des Boutons ou des interrupteurs conçus pour recevoir des commandes et en lancer l'exécution. Dans l'exemple ci-dessous on souhaite piloter indifféremment à partir d'un interrupteur général, un ventilateur ou un 'spot' lumineux par exemple.
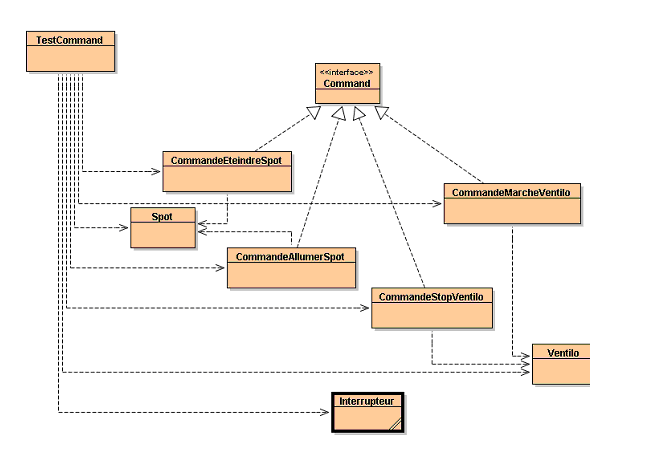
class Ventilo {
public void start () {
System.out.println("Ventilo is rotating");
}
public void stop () {
System.out.println("Ventilo is not rotating");
}
}
class Spot {
public void turnOn( ) {
System.out.println("Spot est allumé ");
}
public void turnOff( ) {
System.out.println("Spot est éteint");
}
}
class Interrupteur {
private Command UpCommand, DownCommand;
public Interrupteur( Command Up, Command Down) {
UpCommand = Up;
DownCommand = Down;
}
void flipUp( ) {
UpCommand . execute ( ) ;
}
void flipDown( ) {
DownCommand . execute ( );
}
}
QUESTION : On demande de programmer les différentes classes de commandes concrètes représentées sur la diagramme UML ci-dessus Ainsi que le test qui déclare et pilote deux interrupteurs associés respectivement à un spot et à un ventilateur.
public class TestCommand {
public static void main(String[] args) {
….
}
}